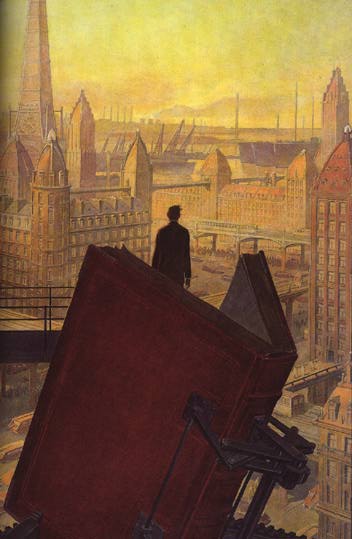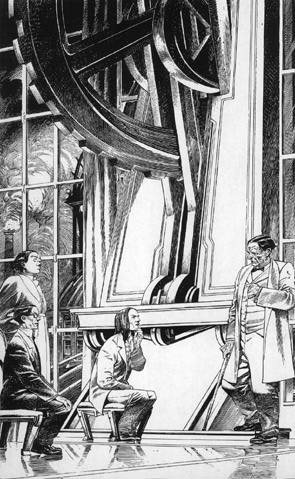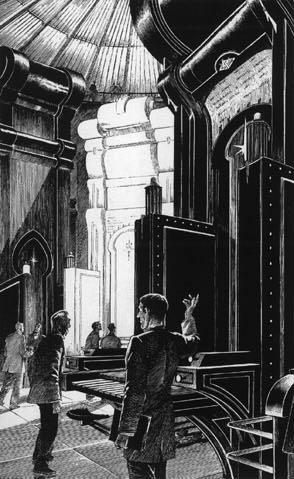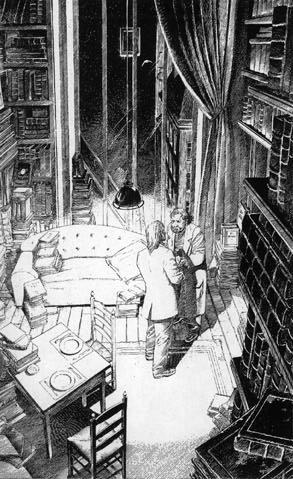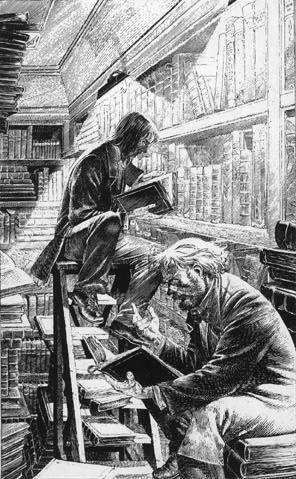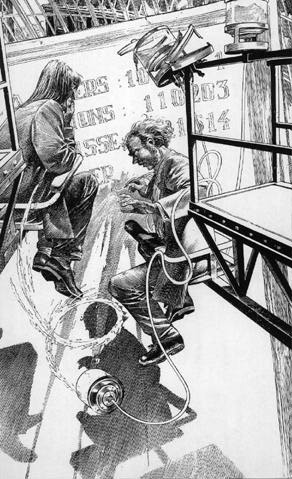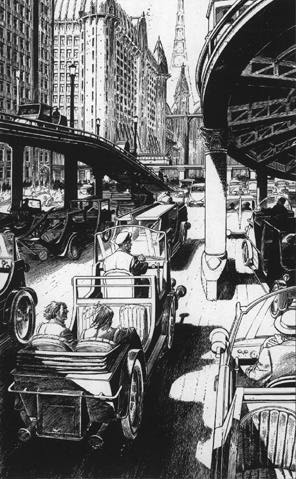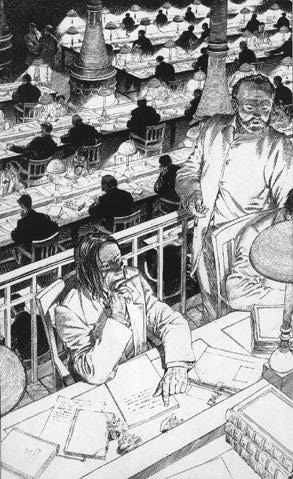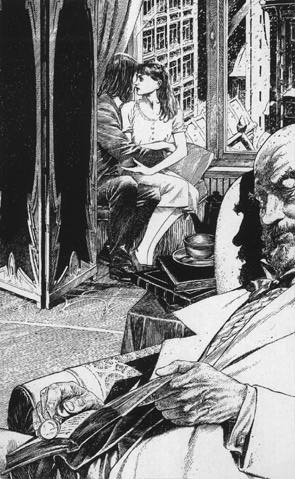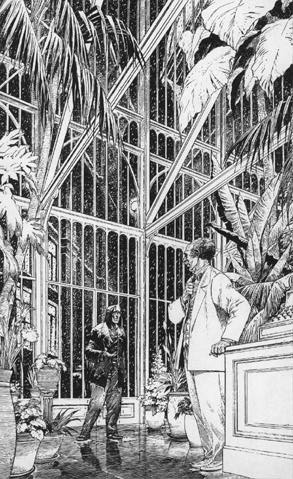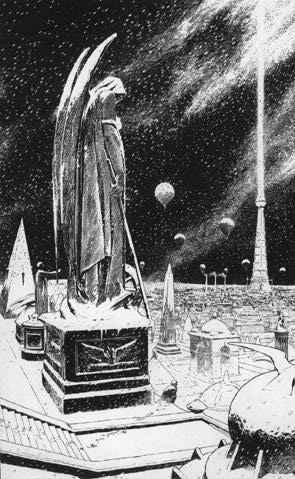©2008 Dr. Guy Spielmann

Paris au XXe siècle de Jules
Verne (1863)
Ce
roman que Jules Verne (1828-1905) écrivit à l'âge
de 22 ans est le quatrième d'une œuvre qui compte plus de
soixante-dix titres publiés sur quarante années, dont
les célébrissimes Cinq semaines en ballon, Le
Tour du monde en quatre-vingts jours, Vingt mille lieues sous
les mers, Voyage au centre de la Terre, De la Terre
à la Lune, etc. Traduits dans de nombreuses langues et fréquemment
adaptés en BD, à la télévision et au cinéma,
les textes de Verne sont parmi les plus universellement connus et diffusés
de la littérature française. Pourtant, l'auteur est longtemps
resté catégorisé comme «écrivain pour
la jeunesse» et donc méprisé par la critique et
l'université.
|
|

Paris
au XXe siècle fut refusé par l'éditeur
Hetzel et l'on crut longtemps que le manuscrit avait disparu.
Retrouvé par hasard dans un coffre-fort, il a finalement
été publié en 1994. |
|
|
Né à Nantes, Jules Verne déménage
à Paris pour y poursuivre des études de droit qu'il termine
en 1850, tout en écrivant des pièces de théâtre
et des nouvelles. Cette même année le succès de sa
pièce Les Pailles rompues en 1850 le pousse à se
lancer dans une carrière dramatique, et il devient même secrétaire
du Théâtre Lyrique en 1852; mais cette réussite se
révèle de courte durée et il abandonne vite l'ambition
de devenir un grand dramaturge. Il se met alors à écrire
des histoire et des articles «alimentaires» pour des revues
relativement populaires, en s'appuyant sur sa passion pour la science
et la technique.
Après s'être marié, Verne, qui peine
à gagner sa vie, obtient par protection un poste d'agent de change
pour la banque Eggly et Cie (1857), ce qui ne l'empêche pas de fréquenter
assidûment la Bibliothèque Nationale où il accumule
de la documentation pour les romans et nouvelles qu'il continue d'écrire.
Sa carrière d'écrivain commence réellement
avec sa rencontre en 1862 avec l'éditeur Pierre-Jules Hetzel, qui,
impressionné par le manuscrit d'«Un voyage en l'air»
(finalement publié sous le titre de Cinq Semaines en ballon),
lui propose un contrat de dix ans—leur collaboration durera presque
quatre décennies.
Si Verne a tôt acquis la célébrité
grâce aux «aventures extraordinaires», qui exploitent
la vague du roman de voyage dans des contrées exotiques, il montre
déjà un goût prononcé pour l'«anticipation»
(le terme de «science-fiction», emprunté à l'anglais,
n'apparaît qu'en 1926) dans ce qu'il nomme le «Roman scientifique»,
rigoureusement documenté.
En réalité, il est loin d'imaginer dans Paris
au XXe siècle un avenir profondément différent
de la réalité de son temps: la vie en 1960 se présente
comme une sorte de développement hypertrophique de celle de 1860
telle que l'envisage le jeune auteur dont le héros, de toute évidence,
représente une manière d'alter ego. De plus, le ton résolument
sombre, pessimiste et même désespéré de ce
roman contraste avec l'optimisme «positiviste» que véhiculent
les «Aventures Extraordinaires».
|
|
|
Illustrations.
Les romans publiés du vivant de Verne comprenaient d'abondantes
illustrations réalisées par Edouard Riou, Alphonse de Neuville,
Jules Ferat, Paul-Dominique Philippoteaux, George Roux et surtout Léon
Benett. Les images qui figurent sur cette page sont dûes à
François Schuiten, principalement connu pour son travail dans la
bande dessinnée, et notamment la série culte Les Cités
obscures (scénarios de Benoît Peeters), dont l'univers
à la fois futuriste et rétrograde correspond parfaitement
à celui de Paris au XXe siècle (Réédition
Hachette, 1995). En 2005, année commémorative, Schuiten
et Peeters ont publié chez Casterman un album intitulé Les
Portes du possible, «journal imaginaire en hommage à
Jules Verne», qui a fait l'objet d'une exposition à la Bibliothèque
Nationale de France (18 octobre 2005 - 15 janvier 2006). |
| |
Chapitre
I:
«Société Générale de Crédit instructionnel.»
Paris, 1960. La société ne connaît
que deux principes moteurs: la technonologie et la finance. La littérature,
les beaux-arts, la musique et tout ce qui n'est pas jugé «utile»
ou «productif» sont méprisés. L'éducation
est gérée par une gigantesque entreprise, la Société
de Crédit instructionnel, dont le jeune Michel Jérôme
Dufrénoy vient d'être fraîchement diplômé
avec un premier prix de vers latin—distinction qui lui vaut les
sarcasmes de l'assistance.
 |
 |
Chapitres
II-III:
«Aperçu général des rues de Paris - Une Famille
éminemment pratique.»
Ses études finies, Michel doit entrer dans
la vie active: mais quel emploi peut bien occuper un tel «rêveur»?
Orphelin, seulement âgé de 16 ans, Michel doit, avec beaucoup
de réticence, s'en remettre à la protection de son oncle,
Stanislas Boutardin, riche et puissant
industriel qui lui fait immédiatement donner un poste à
la banque Casmodage et Cie.
|
|
| Chapitre
IV:
«De quelques auteurs du XIXe siècle, et de la difficulté
de se les procurer.»
Profitant d'une ultime journée de liberté,
Michel va flâner à la bibliothèque Impériale.
Là, il tombe sur son autre oncle, Huguenin, dont
il avait perdu la trace. Ce dernier (qui en fait avait assisté
à la remise des prix sans se faire connaître) l'encourage
à poursuivre ses aspirations et à venir le voir dès
que possible. |
 |
Chapitre
V-VI:
«Où il est traité des machines à calculer, et des caisses
qui se défendent elles-mêmes - Où Quinsonnas apparaît
sous les sommets élevés du Grand Livre.»
Les débuts de Michel à la banque sont
catastrophiques: incapable d'utiliser correctement la machine à
caluler avec laquelle il travaille, il est muté au service de l'enregistrement
(le «Grand Livre»), sous la direction de Quinsonnas,
callligraphe émérite.
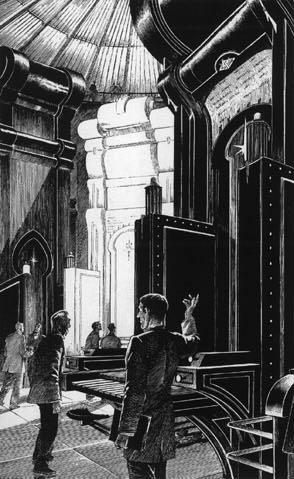
|
 |
Chapitre
VII-VIII:
«- Trois bouches inutiles - Où il est traité de la musique ancienne et
moderne et de l'utilisation pratique de quelques instruments.»
Michel et Quinsonnas sympathisent et, très vite,
ce dernier invite son jeune collaborateur à dîner chez lui.
Là, Michel rencontre Jacques Aubanet, employé
qui aurait voulu être soldat. Les trois hommes font de la musique
en évoquant avec nostalgie un passé ou les beaux-arts n'étaient
pas délaissés.
 |
 |
Chapitre
IX-X:
«Une visite à l'oncle Huguenin - La Grande Revue des auteurs
francaise passée par l'oncle Huguenin, le dimanche 15 avril 1961.»
Quelques mois plus tard, Michel, ayant finalement obtenu
un jour de congé, va rendre visite à l'oncle Huguenin, avec
qui il passe la journée à parler de littérature.
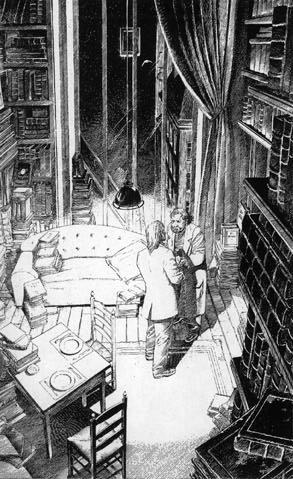 |
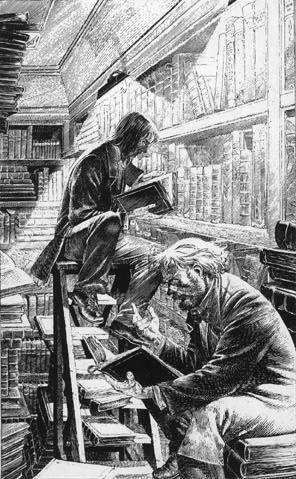 |
Chapitre
XI:
«Une promenade au port de Grenelle.»
Le
soir, Michel et Huguenin
sont rejoints par l'ancien professeur de Michel, Richelot,
accompagnée de sa fille Lucy. Après dîner,
tout petit groupe s'en va visiter le port de Grenelle en guise de promenade. |
 |
| Chapitre
XII:
«Des opinions de Quinsonnas sur les femmes»
Pendant le travail, Michel ne peut s'empêcher
de questionner Quinsonnas sur le sujet des femmes. Celui-ci lui expose
sa vision d'un idéal féminin qui, dit-il, a complètement
disparu, et d'une institution du mariage complètement corrompue.
Michel lui révèle alors qu'il est tombé amoureux,
et la conversation s'anime à tel point que les deux hommes renversent
des flots d'encre sur le «Grand Livre»—et sont immédiatement
congédiés. |
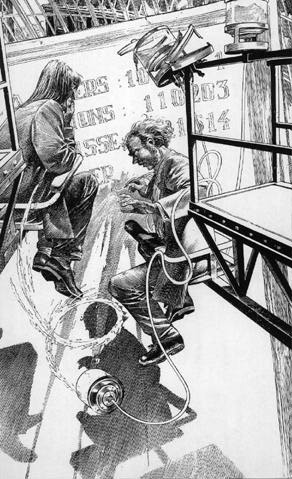 |
Chapitre
XIII:
«Où il est traité de la facilité avec laquelle
un artiste peut mourir de faim au XXe siècle.»
Le lendemain, Michel amène Quinsonnas rencontrer
son oncle Huguenin. Les trois hommes discutent de l'avenir problématique
du jeune homme, et Quinsonnas se lance dans un éloge passionné
de la propriété. On passe en revue les diverses carrières
possibles, sans résultat probant; ne reste finalement que celle
d'auteur dramatique, pour laquelle Michel se sente quelques affinités,
d'autant plus que Quinsonnas s'offre à le recommander auprès
du directeur du «Grand Entrepôt Dramatique». |
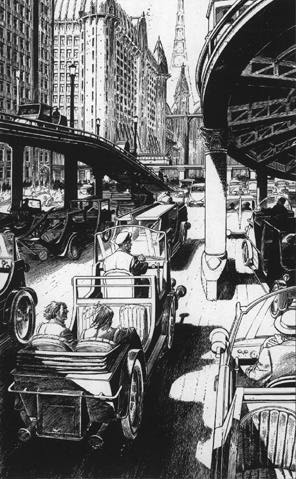 |
| Chapitre
XIV:
Le Grand Entrepôt Dramatique
Dans cet établissement qui résulte de
la volonté de standardiser l'activité théâtrale,
Michel passe un examen d'entrée où il s'agit de composer
sur commande des morceaux stéréotypés. En dépit
d'un travail médiocre, il est engagé aussitôt. Il
découvre que ses activités consistent à remettre
des pièces anciennes au goût du jour, labeur dont il se montre
incapable, d'abord dans la comédie, puis dans le drame et enfin,
le vaudeville. Dégoûté de la bassesse des tâches
qu'on lui assigne, Michel quitte rapidement le Grand Entrepôt Dramatique
et se retrouve donc de nouveau sans emploi et sans ressources. |
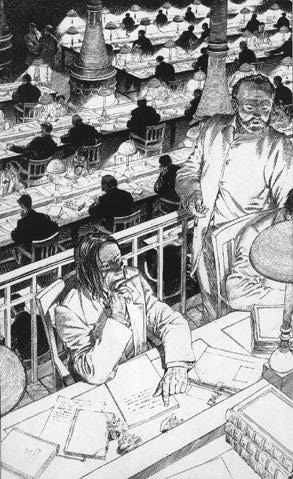 |
| Chapitre
XV:
«Misère.»
Michel et Lucy se déclarent leur amour réciproque,
Quinsonnas quitte Paris pour aller chercher fortune en Allemagne, d'où
il entend bien faire reconnaître ses talents pour revenir ensuire
triomphalement en France.
Désormais sans ressources, Michel tente de gagner
quelque argent en publiant un recueil de poésies, mais ne trouve
pas d'éditeur. Bientôt, il se retrouve dans le dénuement
le plus complet, ne parvenant même pas à magner à
sa faim tandis qu'un hiver particulièrement rude rend les conditions
de vie particulièrement difficiles. |
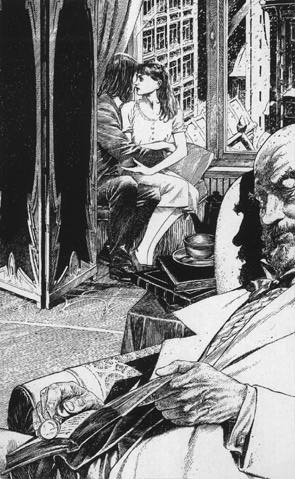 |
| Chapitre
XVI:
«Le Démon de l'électricité.»
Par une nuit glaciale, Michel, affamé et quasiment
délirant, erre dans les rues vides. Il entre dans un magasin de
fleuriste afin d'acheter, avec sa dernière pièce de ving
sols, un petit bouquet pour Lucy; mais en arrivant chez Richelot, il apprend
que celui-ci a étée explusé faute d'avoir payé
son loyer. Le jeune homme continue son errance à travers Paris,
rencontrant partout les preuves du triomphe de la modernité sous
la forme de l'énergie électrique. |
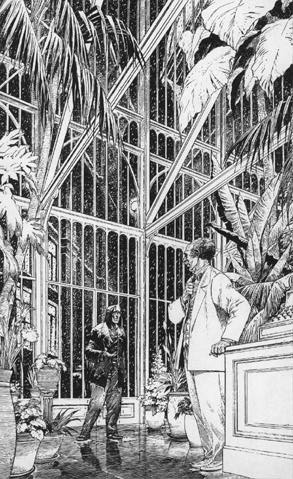 |
Chapitre
XVI:
«Et in pulverem reverteris.»
Au petit jour, Michel se retrouve au cimetière
du Père-Lachaise, où il constate qu'aucun des personnages
qu'il considère comme importants n'a de tombeau digne de ce nom.
Épuisé, affamé, il finit par tomber inanimé
après avoir maudit la ville et invoqué le nom de Lucy. |
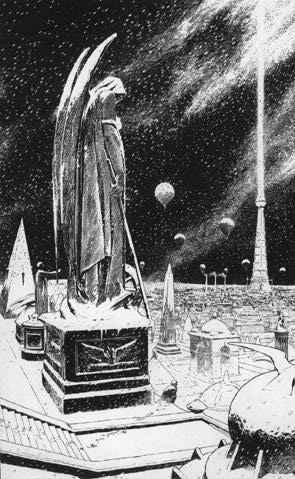 |
Quelques
ressources en ligne sur Jules Verne et son œuvre:
|
| |
|
| |
|
![]()