Sur
le plan strictement matériel, le langage est constituée
d'une série de sons émis par un être humain à
l'aide de ses divers organes
phonatoires.
Le son est une onde produite par la vibration mécanique d'un
support fluide ou solide et propagée grâce à l'élasticité
du milieu environnant sous forme d'ondes longitudinales.
Par extension physiologique, le son désigne la sensation auditive
qui résulte d'une telle vibration, une impression enregistrée
par notre cerveau lorsque des éléments sensoriels de l'oreille
interne sont soumis à vibrations.
En physique, un son est une fréquence vibratoire pure, mesurée
en Herz (Hz), que l'on représente visuellement par une courbe
sinusoïdale. La valeur T (également notée par la
lettre grecque lambda) est appelée «longueur d'onde »,
sachant qu'un Hz équivaut à un cycle par seconde.
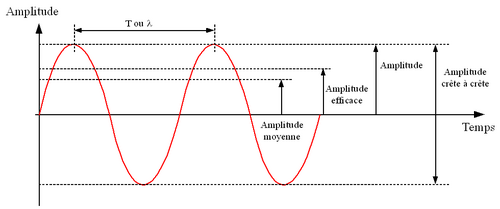
En fait, il est difficile de produire un son pur, car toute fréquence
s'accompagne d'autres fréquences « harmoniques »
(multiples pairs ou impairs de la fréquence), si bien que les
sons de la voix humaine sont toujours complexes. On peut les regrouper
en trois catégories : Périodiques
(réguliers) ou plutôt Pseudo-périodiques :
voyelles et consonnes « voisées » (/b/,/d/) ;
Aléatoires (irréguliers): consonnes « sourdes »
fricatives (/s/, /f/) ; Impulsionels : consonnes
sourdes occlusives (/p/, /t/).
L'étude
des sons du langage s'effectue grâce à instruments de mesure
qui permettent de visualiser sous forme d'oscillogramme et de spectrogramme.
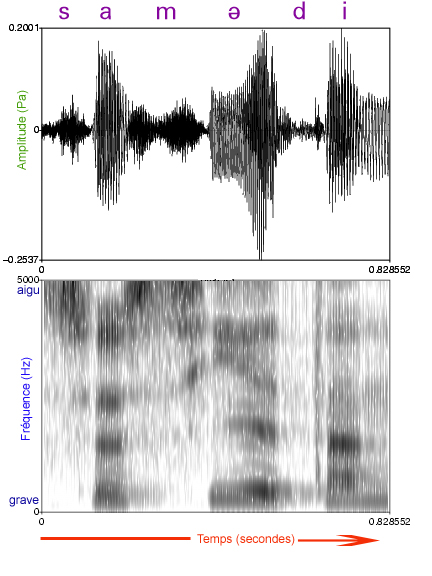
L'oscillogramme,
en haut, montre l'amplitude des vibrations (mesurée
en Pascals) et de spectrogramme montre les fréquences
mesurées en Herz (1 Hz = . Sur le spectrogramme, les zones les
plus sombres représentent les harmoniques (qu'on appelle « formants »).
La fréquence correspond à ce que nous appelons couramment
un son « grave » ou « aigu », ce qui
est relatif à nos capacités de perception. Le champ auditif
humain, assez restreint, se situe entre 20 et 20 000 Hz. Beaucoup d'espèces
animales possèdent des champs plus étendus, notamment
dans l'aigu (ultrasons).
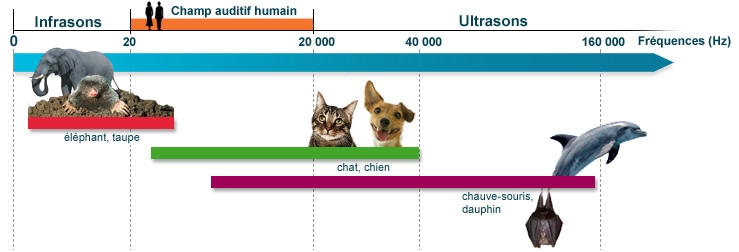
Les
considérations accoustiques de la production et de l'audition
des sons du langage ont mené Roman Jakobson et Morris Halle à
proposer de classifier les phonèmes selon des traits distinctifs
comme 'compact~diffus', 'aigu~grave' et 'strident~mat'.
haut |