|
II.
Analyse
Cette
analyse est un résumé et une synthèse qui ne rend pas
compte de l'intégralité du processus inductif et
empirique qui conduit le lecteur, très progressivement,
à construire complètement le sens du message, et qui
nous permet de déterminer le fonctionnement du système à
partir duquel ce texte est produit.
Les images ci-dessous ne
représentent, à titre d'échantillon, qu'une partie de la
série complète publiée dans la presse, qui comprenait en
tout une quinzaine d 'images différentes
0.
Description générale du corpus:
série d'annonces publicitaires en une page pour la bière
Carlsberg
0.1. A priori, on constate l'existence d'une série de
publicités en une page, qui figuraient isolément (une par
semaine) dans un magazine hebdomadaire d'information
français, L'Express, sur une durée de plusieurs
mois.
0.2. Nous pouvons considérer l'ensemble de ce corpus (la
campagne publicitaire) comme un texte et, dans une première
hypothèse, que chaque page de publicité constitue
une unité liée aux autres par une relation paradigmatique,
puisqu'il n'y a jamais deux de ces publicités à la fois dans
un même magazine.
0.3. Le but du sytème à partir duquel ce texte est produit
peut être décrit comme l'expression d'un message injonctif
par un annonceur (l'émetteur) destiné à un lecteur et
consommateur potentiel (le récepteur), et qu'on peut
formuler linguistiquement comme « Achetez la bière Carlsberg ».
0.4. Dans un deuxième temps, on constate que chacune des
unités (pages individuelles) constitue à son tour un texte
(un microtexte), manifestant un microsystème.
1.
Description des pages individuelles
(microtextes) d'un point de vue communicatif
1.0. Support physique (Medium): encre de
couleur sur papier. Canal visuel direct.
1.1. Code : il est triple : pictural
(image photographique), pictural/linguistique
(logo «Carlsberg beer», intégré à l'image), et linguistique
(slogan « Probably the best beer in the world »).
2.
Description des unités
2.0. La page se décompose en deux éléments: l'image et
le slogan, qui correspondent à deux codages différents.
2.1.0. l'image comporte trois sous-ensembles le logo
« Carlsberg Beer », le véhicule qui
porte le logo, et le décor.
2.1.1. Le logo est un ensemble invariant de trois formants:
- un
syntagme nominal en anglais, « Carlsberg Beer »
- un
graphisme particulier (une police d'imprimerie)
- la
combinaison de deux couleurs: blanc pour les lettres,
vert pour le champ
2.1.2.
Les diverses instances de décor (forêt, champs
cultivés, fleuve, désert, etc.) n'ont pas d'autre point
commun que d'être un décor, et n'expriment pas chacune un
sens particulier. (voir 4.1.1.) Le décor (en général)
fonctionne donc comme unité au niveau de la page
(microtexte); chacun des décors observables, en particulier,
n'est qu'une variante paradigmatique de cette même unité (un
allomorphe).
2.1.3. Un terme comme « véhicule » (ou
« moyen de transport ») désigne une catégorie
générale qui englobe à la fois un camion, une péniche, un
train, et même, par synecdoque, un container (Fig. 11), les
différences entre les divers véhicules n'étant pas
pertinentes du point de vue du sens. Le véhicule (en
général) fonctionne donc comme unité au niveau de la page
(microtexte) ; chacun des véhicules observables, en
particulier, n'est qu'une variante paradigmatique de cette
même unité (un allomorphe).
2.2.0 Le slogan se décompose en deux parties
invariables : le syntagme nominal « Carlsberg
Beer » (voir 2.1.1.), et un deuxième syntagme
nominal en anglais, « Probably the best beer in the
world ».
2.2.1. « Probably the best beer in the world »
apparaît au bas de l'image en caractères gris clair,
relativements petits par rapport à la taille de l'image, et
donc peu visibles.
2.3.0
. On peut représenter schématiquement le système de façon analytique
comme suit :
PAGE
IMAGE
[code icônique]
DECOR
Variable |
VEHICULE
Variable |
|
TEXTE
[code symbolique]
LOGO
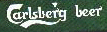 |
SLOGAN
Probably
the best beer in the world |
|
|
2.3.0
. On peut représenter schématiquement le système de façon analogique
comme suit :
PAGE
IMAGE
DECOR
Variable
VEHICULE
Variable
TEXTE
LOGO
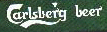 |
|
|
|
|
TEXTE
SLOGAN
Probably
the best beer in the world |
|
|
3.
Analyse du microtexte (la page)
3.0.
Axe syntagmatique
3.0.1. Le texte consiste en un seul syntagme comprenant
quatre unités [décor-véhicule-logo-slogan], dont deux
manifestent des micro-sytèmes.
3.0.2. Ces quatres unités sont toujours présentes
simultanément.
3.0.3. Malgré cette simultanéité, un « ordre de
lecture » s'impose : bien que le décor occupe la
plus grande surface, l'œil est attiré par le véhicule et le
logo, qui forment ensemble le point de focalisation du
texte. Le slogan, en revanche, n'est pas en évidence et sera
vraisemblablement vu et lu en dernier.
3.1.
Axe paradigmatique
3.1.0. Le logo et le slogan étant des unités invariables,
seuls le décor et le véhicule constituent des paradigmes.
3.1.1. Les différences entre les divers décors et véhicules
ne modifient pas le sens du message, et ne représentent donc
pas des oppositions, mais des variantes (allomorphes)
3.1.2. Dans le cadre d'un macrosystème de la
« publicité écrite », on peut postuler un syntagme
[image-texte], dont l'élément « image » est
faculatif.
3.1.2.0. L'élément « image » est analysable en un
syntagme [produit-décor], dont l'un des deux éléments peut
être constitué par un « signifiant zéro » (Ø),
c'est-à-dire une « absence qui signifie ». (Il
peut y avoir soit un décor sans produit, soit un produit
sans décor, soit à la fois le produit et un décor)
3.1.3.1. Les paradigmes possibles où pourraient figurer les
quatres unités peuvent se décrire empiriquement comme suit,
à partir de l'ensemble des publicités écrites pour la bière
existantes :
a)
pour le décor : scènes directement liées à la
fabrication, la vente ou la consommation de la bière
(une brasserie, un magasin, un bar, une soirée entre
amis); un buveur de bière en action, etc.
b) pour le véhicule : un récipient (boîte,
bouteille, verre) de bière photographié ou dessiné, ou
tout autre signe du produit.
c) pour le logo : le logo d'une autre marque et
d'un autre type (contenant un élément icônique, par
exemple)
d) pour le slogan : variations de forme, comme un
type d'énoncé différent (phrase complète, question), ou
un texte composé de plusieurs énoncés ; variations
de substance, comme une description précise des qualités
de la bière, un texte narratif sur les modalités de
consommation de la bière, etc.
Haut
4.
Analyse du fonctionnement du sytème
4.0.
Analyse globale
4.0.1. Le produit lui même n'est ni montré, ni signifié
allusivement par le décor. Le véhicule signifie le produit
par une relation de synecdoque (le contenant pour le
contenu, comme par exemple dans l'expression « boire un
verre »).
4.0.2. Puisque la bière n'est pas montrée, La compréhension
du message présuppose que le lecteur soit connaisse déjà la
marque « Carlsberg », soit qu'il puisse
interprêter le mot «beer», dans le logo et dans le slogan.
4.0.3. Toutefois, le logo n'est que partiellement visible
sur certaines des images, ce qui montre que l'annonceur
suppose chez le lecteur une connaissance préalable de ce
logo (connaissance acquise en partie grâce aux publicités
antérieures, ce qui suggèrerait un ordre chronologique), qui
est alors lu globalement comme un seul symbole icônique, et
non pas déchiffré analytiquement comme énoncé
linguistique—hypothèse que renforce le principe de
fonctionnement d'un logo en général. Une autre possibilité
réside dans la présomption que le lecteur peut reconstituer
le message grâce à une interpolation guidée par sa logique
linguistique (quand le logo est partiellement caché par des
arbres, par exemple).
4.0.4. D'autre part, le syntagme « probably the
best beer in the world », pris isolément , n'est
pas interprétable en l'absence de référent indexical pour le
mot « beer » sur l'image. Il peut le
devenir pour le lecteur déjà familiarisé avec la campagne de
publicité; il fonctionne alors globalement et par
association (métonymie) comme signifiant de la bière
Carlsberg, tout comme l'énoncé « just do it »
est un signifiant métonymique de la marque de vêtements
sportifs Nike.
4.0.5. De même, l'image seule peut toujours s'interpréter
isolément, mais à condition que le lecteur connaisse déjà le
logo.
4.0.6. Sur l'ensemble du message Les deux syntagmes nominaux
(logo et slogan) peuvent se lire comme une phrase elliptique
sans verbe-copule : « Carlsberg beer ... [is]
... probably the best beer in the world ».
4.1.
Le décor
4.1.0. Le décor évoque un milieu ou une région d'un type
aisément reconnaissable (un champ, un pont, une rizière),
mais impossible à spécifier avec exactitude, car il ne
comporte pas de monument ou de détail topographique
clairement identifiable (par ex. la tour Eiffel, le Taj
Mahal, Ayers Rock).
4.1.1. Dans le cadre du macrotexte (une série de plusieurs
pages publicitaires), la variation des décors fonctionne
comme métaphore du 'monde en général'. A ce niveau, il
existe donc une relation syntagmatique entre les diverses
pages, puisqu'il faut en avoir vu plusieurs pour
comprendre que chaque décor n'a pas de sens individuel, et
que « le monde » est signifié par la
juxtaposition de plusieurs décors différents. En
effet, le sens de tout texte se construit diachroniquement
au fur et à mesure de la lecture.
4.2.
Le slogan
4.2.0. Le slogan est formé par deux syntagmes nominaux qui
peuvent se lire comme une phrase elliptique sans
verbe-copule : « Carlsberg beer ... [is]
... probably the best beer in the world ». En
tant que sous-système, le slogan participe à la fois de
l'image et du texte.
4.2.1. Le fait que le slogan soit en anglais est pertinent
dans la mesure où le lecteur présomptif de L'Express
est francophone.
4.2.2. L'énoncé de type déclaratif affirme une
supériorité, mais sans la prouver ni l'expliquer. Sa valeur
de vérité est faible, surtout en l'absence de sujet
énonciatif identifié (par exempe, une personnalité connue
qui offre sa garantie personnelle, stratégie fréquente en
publicité).
4.2.3. L'adverbe « probably » semble
neutraliser, sinon contredire, le superlatif « best
in the world » ; son usage est donc
problématique.
Haut
5.
Interprétation
5.0.
Sens global
5.0.1. On sait que le sens global du message est fixe, lié à
sa destination publicitaire : « Achetez la bière
Carlsberg ». C'est, par excellence, un énoncé
perlocutif, puisqu'il a pour objectif d'inciter
l'énonciataire à agir.
5.0.2. Ce sens n'est toutefois pas directement dénoté par le
syntagme décor-véhicule-logo-slogan, ni par aucune de ces
unités prises séparément. Il repose donc sur un syllogisme
:
majeure
(implicite) : « Vous voulez boire la
meilleure bière du monde. »
mineure (donnée par le slogan) :
« Carlsberg est probablement la meilleure bière du
monde. »
conclusion (implicite) : « Vous devez
acheter Carlsberg. »
Ce
syllogisme repose lui même sur la prémisse implicite :
« Vous voulez boire de la bière » (on peut dire
aussi que « Vous voulez boire la meilleure bière du
monde » présuppose « Vous voulez
boire de la bière »). Ici, l'annonceur présume que le
lecteur désire acheter de la bière, par opposition aux
campagnes de publicité pour un type de produit (pommes,
lait, boeuf, etc.), où l'annonceur ne présume pas que le
lecteur désire déjà le type de produit dont il fait la
réclame. Ce message aurait donc un sens pour un lecteur qui
déteste la bière, mais aucune valeur incitative.
5.1.
Argument de vente
5.1.0. L'argument de vente est ici la qualité (par
opposition au prix, à l'apparence, à la mode, aux bienfaits
pour la santé, à la tradition, etc.), bien que cette qualité
reste totalement abstraite (on aurait pu vanter la qualité
des ingrédients, la pureté de l'eau, la méthode de brassage,
etc.), et que rien dans le message ne signifie 'qualité',
sauf le syntagme « best... in the world ».
5.1.1. La variation des décors, globalement signifiante du
'monde', vise donc à renforcer le signifié de « qualité
au niveau mondial » (par opposition au niveau local,
régional, continental), mais uniquement par
association : le simple fait que cette bière est
présente partout dans le monde impliquerait donc qu'elle est
« probablement la meilleure du monde ». On peut
donc reformuler le syllogisme comme suit :
prémisse
(donnée par l'image) : La présence du camion de
bière dans divers endroits à travers le monde
majeure (implicite) : « La bière
Carlsberg est vendue partout dans le monde. »
mineure (implicite) : « Une bière vendue
partout dans le monde est probablement la meilleure du
monde. »
conclusion (donnée par le slogan):
« Carlsberg est probablement la meilleure bière du
monde. »
5.1.2.
La présence de « probably », signalée
plus haut comme problématique, peut alors s'expliquer par la
très faible valeur de vérité de
l'affirmation et de sa justification. L'introduction de
l'adverbe permet de désamorcer toute critique quant à la
véracité de « best beer in the world »,
et rend donc licite ce qui pourrait passer pour une
exaggération, voire une hyperbole—comment peut-on déterminer
objectivement qu'une bière est la meilleure du monde ?
Une autre hypothèse, qui n'exclut pas la première,
consisterait à voir dans l'adverbe un moyen de sigulariser
« the best beer in the world », énoncé
par trop générique pour faire un bon slogan.
5.2.
Utilisation de l'anglais
5.2.0. L'utilisation de l'anglais est problématique à double
titre : d'une part, il s'agit d'une bière danoise et
l'anglais n'est pas langue officielle au Danemark, et
d'autre part la publicité s'adresse à un lecteur
francophone.
5.2.1. Dans le système communicatif de la publicité,
l'anglais fonctionne souvent comme langue internationale, en
tout cas à un certain niveau socio-culturel ; on
considère que des énoncés en anglais simple sont
compréhensibles par tout lecteur éduqué.
5.2.2. De plus, le lecteur de L'Express n'est pas un
« francophone moyen », mais une personne plutôt
éduquée qui a presque certainement des rudiments d'anglais
suffisants pour comprendre le slogan.
5.2.3. Enfin, cette publicité paraît dans l'édition
internationale de L'Express, dont le lectorat est
constitué de francophones vivant partout dans le monde et
d'un niveau socio-économique élevé. On comprend alors que le
signifié 'monde', déjà représenté par deux signifiants—la
série de décors (et non pas chaque décor pris
individuellement), et le mot « world »—l'est
également par l'usage de l'anglais. Le signifié est donc
plutôt le 'cosmopolitisme' que le 'monde' lui-même, par métonymie
(lien d'association : le cosmopolitisme est l'attitude
d'un l'individu vis-à-vis de la diversité du monde).
6.
Conclusion
On
peut donc reconstituer une chaîne syllogique complexe dont
seulement deux éléments sont explicites dans la publicité:
prémisse
générale (implicite à l'existence de ce
texte) : « Je [énonciateur] dis que vous
[énonciataire] voulez boire de la bière ».
prémisse 1 (donnée
par l'image) : « Je
[énonciateur] vous
[énonciataire] dis que La
bière Carlsberg est présente partout dans le
monde ».
prémisse 2 (donnée par le contexte) :
« Je
[énonciateur] dis
que vous [énonciataire]
êtes une personne cosmopolite et éduquée ».
majeure 1 (implicite) : « Je
[énonciateur] vous
[énonciataire] dis qu' une
bière présente partout dans le monde est probablement la
meilleure du monde ».
majeure 2 (implicite) : « Je
[énonciateur] vous
[énonciataire] dis qu'une
personne cosmopolite et éduquée sait reconnaître (et
désire) les meilleurs produits ».
mineure 1 (donnée
par le slogan) : « Je
[énonciateur] vous
[énonciataire] dis que Carlsberg
est probablement la meilleure bière du monde».
mineure 2 (implicite): « Je
[énonciateur] vous
[énonciataire] dis que donc,
vous allez aimer Carlsberg ».
conclusion générale (implicite) : « Je
[énonciateur] vous
[énonciataire] dis que vous
devez acheter Carlsberg ».
|