II.
la phrase complexe:
juxtaposition, coordination et subordination
Une
phrase complexe est constituée par plusieurs propositions,
liées de trois manières possibles.
I.
La juxtaposition
Elle consiste à placer des propositions
l'une à la suite de l'autre en utilisant seulement la ponctuation:
virgule, point-virgule, deux points, parenthèses et tirets.
«Je
suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu.»
«Il fait trop froid ici; allons dans un autre pièce.»
«Nous n'avons plus qu'une seule possibilité: donnons-lui
ce qu'il demande.»
«Elle est sortie sans un mot (avait-elle le choix?).»
«Mes parents quittèrent l'Algérie en 1961—ce
ne furent certes pas les seuls!»
Cette
possibilité reste, à l'écrit, d'un usage limité.
II. La coordination
Elle consiste à lier des propositions à
l'aide d'une conjonction de coordination: «mais», «ou»,
«et, «donc», «or», «ni»,
«car». Solution pratique—le nombre de conjonctions
est très limité, et l'opération ne nécessite
presque aucun ajustement—, elle reste néanmoins d'usage
limité à l'écrit, car elle exige que les propositions
soient parallèles. Dans l'exemple suivant, elles ont le même
sujet et une même structure de base Sujet-Verbe-COD:
«Le
ministre de l’intérieur a déclaré l’état
d’urgence dans les départements du Gard et de l’Hérault
avant l’arrivée des pluies diluviennes prévues
dans les jours prochains, car il craint la répétition
des problèmes survenus lors des innondations de 1999.»
(Dépêche de l'AFP.)

Ici,
la seule opération nécessaire est la pronominalisation
du nom sujet (le ministre > il) dans la deuxième proposition.
Pour l'analyse, on dira
donc que la deuxième proposition est coordonnée à
la première, nommée «proposition principale».
|
III.
La subordination et autres procédés de structuration
complexe.
La subordination consiste à lier
des propositions à l'aide d'une conjonction de subordination:
«quand», «bien que», «comme»,
«si», «avant que», ect. Parfois moins simple
à mettre en pratique, elle est nécessaire à l'expression
des nuances dans les rapports de sens entre les diverses propositions,
et indispensable lorsque les propositions ne sont pas parallèles,
ou si l'on doit enchâsser plusieurs propositions les unes dans
les autres. Elle nécessite parfois des ajustements multiples,
en particulier dans les formes verbales (pour respecter la «concordance
des temps».
La subordination relative consiste à lier des propositions
à l'aide d'un pronom relatif. Cette solution nécessite
la présence dans la proposition principale d'un substantif
référent (nom ou pronom)
«Patissot,
en s'en allant, fut pris d'une immense considération pour
cet homme, non pas tant à cause de ses grands succès,
de sa gloire et de son talent, mais parce qu'il mettait tant d'argent
pour une fantaisie, tandis que les bourgeois ordinaires se privent
de toute fantaisie pour amasser de l'argent.» (Guy de Maupassant,
Contes parisiens.)
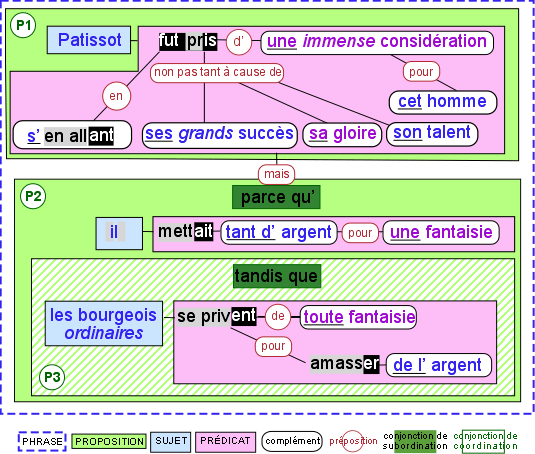
Cette
phrase comprend une proposition principale [P1],
et deux propositions subordonnées [P2]
et [P3], qui est enchâssée
dans [P2]. Les deux autres verbes (amasser
et allant), en revanche, ne forment pas de propositions,
mais jouent le rôle de compléments, parce qu'ils sont
régis par des prépositions et n'ont pas de sujet propre. |